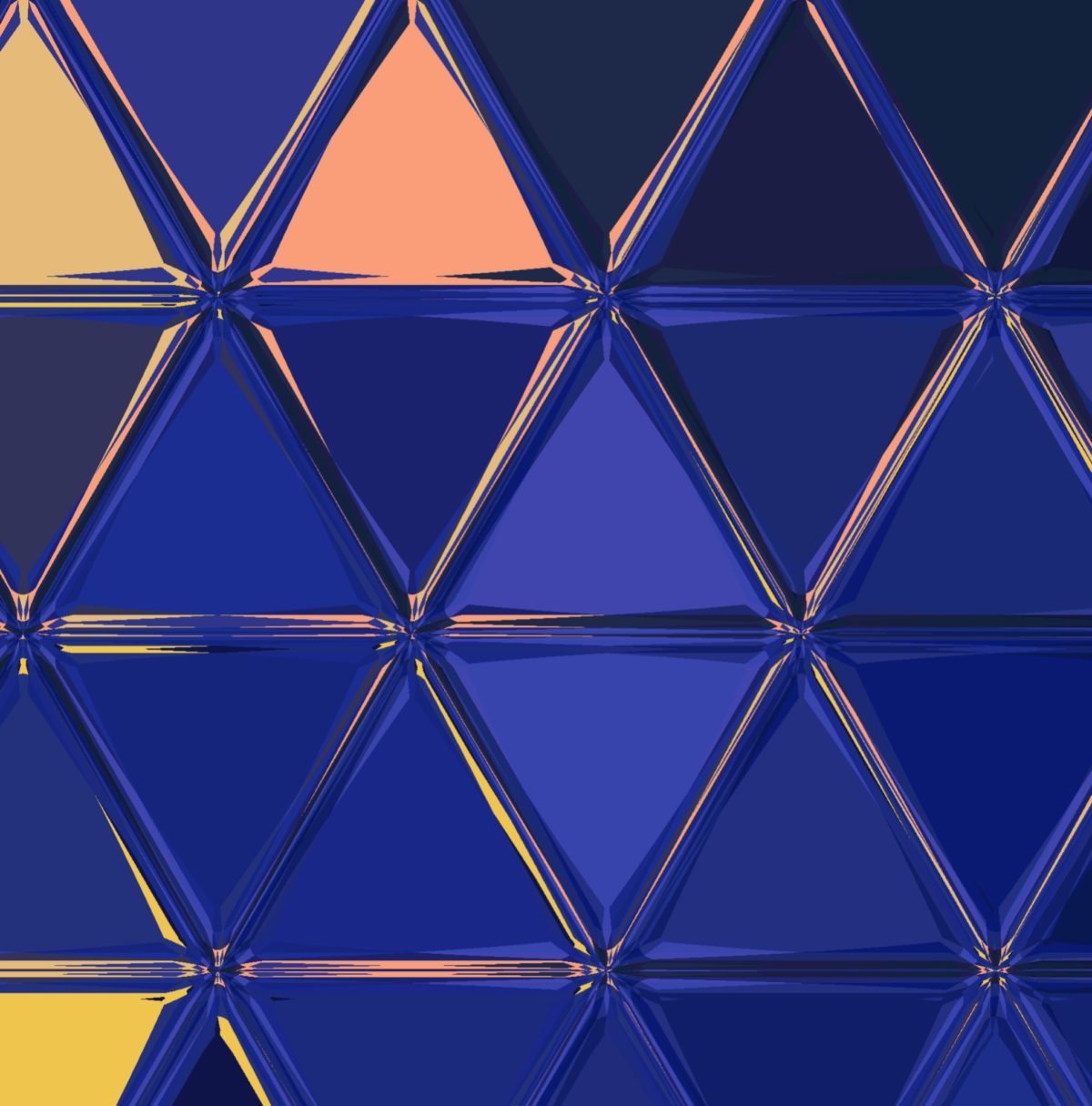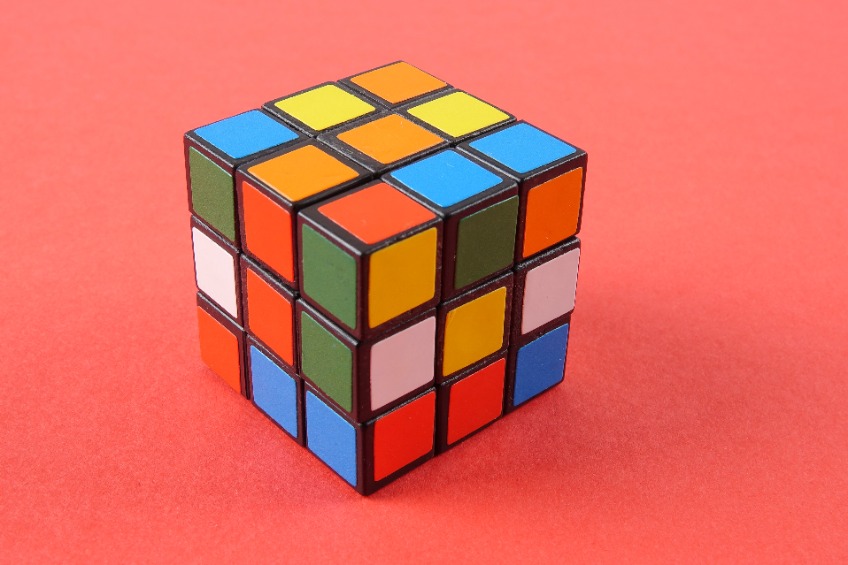Publié dans la revue Jurisprudence Sociale Lamy n° 517 du 5 avril 2021.
Disponible en téléchargement PDF à la fin de l’article.
Cass. soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.113, arrêt n° 8 F-D
Dès lors que la directrice générale de l’association n’avait pas qualité pour signer la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture, faute d’avoir reçu le mandat spécial du conseil d’administration prévu par les statuts associatifs, ce manquement est insusceptible de régularisation et le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Les faits
La directrice générale de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) des Bouches-du-Rhône, association loi 1901, bénéficiait d’une délégation de pouvoir générale en matière de gestion des ressources humaines, signée par le président de l’association et précisant que « Le directeur dispose du pouvoir disciplinaire. Il peut engager une procédure de licenciement après avoir recueilli l’accord préalable du président ». Le président a donné pouvoir et autorisé la directrice générale à engager une procédure de licenciement pour faute grave à l’encontre d’un salarié et à signer en son nom les courriers relatifs à cette procédure. La lettre de licenciement du salarié a ainsi été signée par la directrice générale « pour le Président de l’UDAF et par délégation ». Contestant le bienfondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes et argumentations
Dans cette affaire, les statuts associatifs prévoyaient que le conseil d’administration (CA) de l’association a tous les pouvoirs utiles au fonctionnement de cette dernière et qu’il peut déléguer une partie de ceux-ci au bureau. Les dispositions statutaires précisaient également que le président représente l’UDAF en justice et dans tous les actes de la vie civile, pour lesquels il dispose d’une délégation permanente. En l’absence du président, la représentation de l’UDAF est exercée par un vice-président ou un délégué mandaté spécialement par le conseil d’administration à cet effet.
Interprétant ces dispositions, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que le salarié déduisait à juste titre des statuts que la directrice générale n’avait pas qualité, en l’absence du président de l’UDAF, pour signer la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de rupture, n’ayant pas été mandatée spécialement par le conseil d’administration pour exercer la représentation de l’association dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement qui s’analyse en un acte de la vie civile.
Pourtant, l’UDAF indiquait que la délégation de pouvoir consentie par le président à la directrice générale avait été spécialement validée par le conseil d’administration, produisant à cet effet des procès-verbaux de l’organe ainsi que trois attestations du président et de deux administrateurs. Selon les juges du fond, ces éléments étaient insuffisants à établir la réalité du mandat spécial exigé par les statuts, ne précisant pas le contenu de la délégation de pouvoir accordée à la directrice générale et ne portant mention que de deux signatures d’administrateurs ainsi qu’une autre signature dont l’identité du signataire n’apparaissait pas.
L’employeur a formé un pourvoi contre cet arrêt, invoquant une violation des articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail.
La décision, son analyse et sa portée
La Cour de cassation n’a pas suivi les arguments développés par l’employeur, jugeant tout d’abord non fondés sur un moyen sérieux de cassation les arguments de l’employeur selon lesquels le mandat spécial n’est soumis à aucune règle de forme, la délégation de pouvoir donnée par le président à la directrice générale était claire et précise en ce qu’elle prévoyait expressément que celle-ci « dispose du pouvoir disciplinaire (…) et peut engager une procédure de licenciement après avoir recueilli l’accord préalable du président », cette délégation ayant été validée à l’unanimité par le conseil d’administration et n’exigeant pas d’établir un mandat distinct.
Par suite, la Cour juge que « la cour d’appel, qui a constaté que la directrice générale de l’UDAF 13 n’avait pas qualité pour signer la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture, faute d’avoir reçu mandat du conseil d’administration, en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. »
- La sévérité jurisprudentielle au sein du secteur associatif
Cette décision s’inscrit dans la droite lignée de la position de la Cour de cassation depuis de nombreuses années. À cet égard, le constat est celui d’une particulière sévérité : quand bien même le licenciement serait justifié par une cause réelle et sérieuse, si le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas compétence pour procéder à la rupture du contrat de travail, cette dernière est injustifiée sans qu’aucune régularisation ne soit possible (Cass. soc., 4 avril 2016, n° 04-47.677). Ainsi, le défaut de pouvoir du signataire n’est pas une simple irrégularité procédurale mais une cause de licenciement injustifié ouvrant droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts suivant le « barème » fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Cette sévérité, spécifique au secteur associatif, a d’ailleurs conduit l’association Les Républicains (le parti politique) a formuler une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée : « L’article L. 1232-6 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe d’égalité, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 2 de la constitution, et au principe fondamental reconnu par les lois de la République de liberté d’association, en ce qu’il impose que, dans les associations et contrairement aux sociétés, le signataire de la lettre de licenciement doit être l’organe désigné à cette fin par les statuts ou la personne qu’il délègue expressément à cette fin dans le respect des statuts ? ». La Cour n’a pas renvoyé la question, jugeant que cette disposition « a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2019-787 QPC du 7 juin 2019 rendue par le Conseil constitutionnel ; qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen » (Cass. soc., 6 novembre 2019, 19-15.632). Or, si le Conseil constitutionnel a effectivement jugé l’article L. 1232-6 du code du travail conforme à la Constitution, il n’était nullement question de l’interprétation très stricte faite de cet article par la Cour de cassation s’agissant spécifiquement des associations.
Une subtilité est toutefois à relever s’agissant de la convocation à l’entretien préalable : la Cour de cassation juge qu’il « entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement » (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.213). Or, cette mise en œuvre commence dès la convocation à l’entretien préalable qui doit être signée par la personne ayant pouvoir à cet effet. Toutefois et conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 du Code du travail dans sa version applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’irrégularité résultant d’un manquement lié à cette convocation n’est pas sanctionnée par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais par une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Au demeurant, la décision du 6 janvier 2021 confirme une jurisprudence constante qui doit inciter les associations et fondations, avant l’engagement d’une procédure de licenciement, à vérifier leurs statuts et l’existence d’une éventuelle délégation de pouvoir.
- La vérification systématique des dispositions statutaires
Au sein des associations et fondations, les statuts – et le règlement intérieur associatif s’il existe – régissent les pouvoirs et compétences respectives de l’assemblée générale, du conseil d’administration, de son bureau et notamment de son président.
En pratique, on constate que la détermination de la personne disposant du pouvoir de licencier, et plus généralement habilitée à gérer le personnel, n’est que peu fréquemment anticipée par les rédacteurs des statuts associatifs. En effet, il est assez rare de lire des dispositions statutaires précisant clairement quel est l’organe compétent en la matière.
La Cour de cassation juge de façon constante que dans le silence des statuts et sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, le pouvoir de mettre en œuvre la procédure de licenciement entre dans les attributions du président de l’association (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.213 ; Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-22.158). Il en va de même si le président décide spontanément de consulter le conseil d’administration sur un projet de licenciement : s’il ne s’agit pas d’une obligation statutaire, le président n’est pas lié par la décision de cet organe (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-15.296).
La situation est plus délicate lorsque les dispositions statutaires ne sont pas silencieuses, mais ambiguës. Dans cette hypothèse, le pouvoir d’interprétation des juges est nécessairement source d’insécurité juridique.
Par exemple, dans une affaire récente, les statuts associatifs prévoyaient que « le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales » et que « Le Président (…) fait exécuter les décisions arrêtées par le Bureau et le Conseil d’administration. Il veille au bon fonctionnement de l’association qu’il représente dans ses rapports avec les milieux économiques, avec les collectivités territoriales, les administrations et les actes de la vie civile. Il est investi de tous pouvoirs à cet effet, sous réserve des attributions délivrées par les présents statuts aux assemblées générales et au Conseil d’administration (…). il peut déléguer certaines de ses prérogatives dans le cadre d’une délégation de pouvoirs ou de signature ». Alors que la Cour d’appel de Reims avait considéré que le pouvoir de licencier relevait de « ceux largement dévolus au conseil d’administration, le président devant agir dans le respect de ceux ressortissant à cet organe », la Cour de cassation a considéré que « les statuts de l’association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, à l’exception de la nomination et de la révocation du directeur général de l’association par le conseil d’administration, de sorte qu’il entrait dans les attributions de son président de mettre en œuvre la procédure de licenciement susvisés » (Cass. soc., 14 octobre 2020, n° 19-18.574).
Aussi et suivant une logique de « parallélisme », si les statuts prévoient que tel organe est compétent pour nommer une personne, ce même organe est nécessairement compétent pour la démettre de ses fonctions (Cass. soc., 2 octobre 2019, n° 17-28.940).
- La vérification de l’existence d’une délégation de pouvoir et de sa validité
À l’instar des sociétés, la délégation de pouvoir est un outil organisationnel, managérial et de sécurisation juridique incontournable au sein des associations. Au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, les délégations de pouvoir vont de pair avec le document unique de délégation qui précise les compétences et missions confiées par délégation au professionnel chargé de la direction d’un établissement ou service (article D. 312-176-5 du Code de l’action sociale et des familles).
Compte tenu de ce qui précède, il est essentiel de vérifier le contenu des statuts et le cas échéant du règlement intérieur associatif, tant pour déterminer l’organe titulaire du pouvoir de licencier – puisque seul celui-ci sera habilité à déléguer ce pouvoir – que l’existence de règles éventuelles encadrant la délégation des pouvoirs au sein de l’association. Par exemple, la seule mention au sein du contrat de travail du pouvoir de procéder aux licenciements en accord avec le président est insuffisante, les juges devant rechercher si une délégation avait été donnée par le conseil d’administration conformément aux règles statutaires (Cass. soc., 25 septembre 2013, 12-14.991). Aussi, il n’est pas rare de trouver des dispositions statutaires exigeant que toute délégation de pouvoir permanente consentie au sein de l’association doit être préalablement approuvée par le conseil d’administration ou le président.
Très récemment, la Cour d’appel de Versailles a synthétisé les règles applicables en rappelant que l’association est tenue de produire une « délégation expresse », que « la théorie du mandat apparent n’est pas applicable à une association dont les règles en matière de pouvoir de licencier sont plus strictes que celles applicables à une société » et que « le parallélisme des formes du signataire des contrats de travail et de la lettre de licenciement ne peut être invoqué pour faire échec à l’application des règles prévues par les statuts de l’association » (CA Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, n° 18/02816).
Ainsi, face à un contentieux abondant, une jurisprudence particulièrement sévère et des conséquences financières pouvant être très conséquentes dans un secteur pourtant soumis à des contraintes budgétaires évidentes, la plus grande vigilance est de mise.
Stéphane Picard & Cécile Noël
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2019), M. S… a été engagé en qualité de technicien système et méthodes par l’Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône (l’UDAF 13) à compter du 1er février 2002 et occupait en dernier lieu l’emploi de responsable de service.
2. Il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2014 et a saisi la juridiction prud’homale d’une demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu’en tout état de cause le licenciement prononcé par un salarié qui ne bénéficie pas d’une délégation écrite et dont les fonctions ne permettent pas de lui reconnaître une délégation du pouvoir de licencier peut être validé par la personne morale employeur si elle soutient sans équivoque le bien-fondé de l’acte ou a laissé la procédure de licenciement aller à son terme ; qu’en l’espèce, il est constant que l’UDAF 13 a mené la procédure de licenciement de M. S… jusqu’à son terme et a validé la signature de la lettre de licenciement par la directrice générale de l’association tout au long des procédures disciplinaire et prud’homale l’opposant à M. S… ; qu’en jugeant néanmoins que le licenciement de M. S… était privé de cause réelle et sérieuse à raison du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, bien que ce vice ait été ratifié par l’UDAF 13 de manière claire et univoque, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, qui a constaté que la directrice générale de l’UDAF 13 n’avait pas qualité pour signer la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture, faute d’avoir reçu mandat du conseil d’administration, en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi (…)