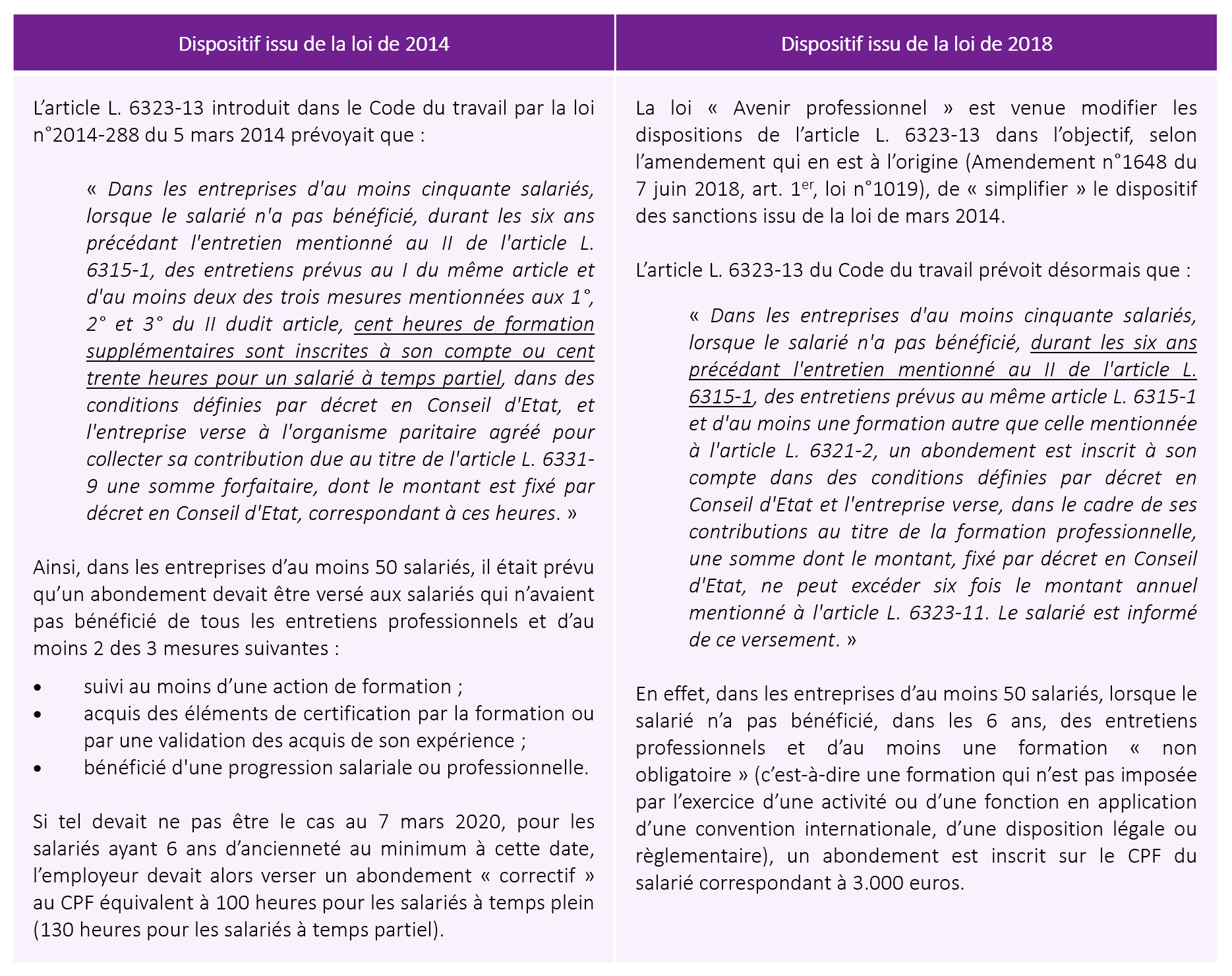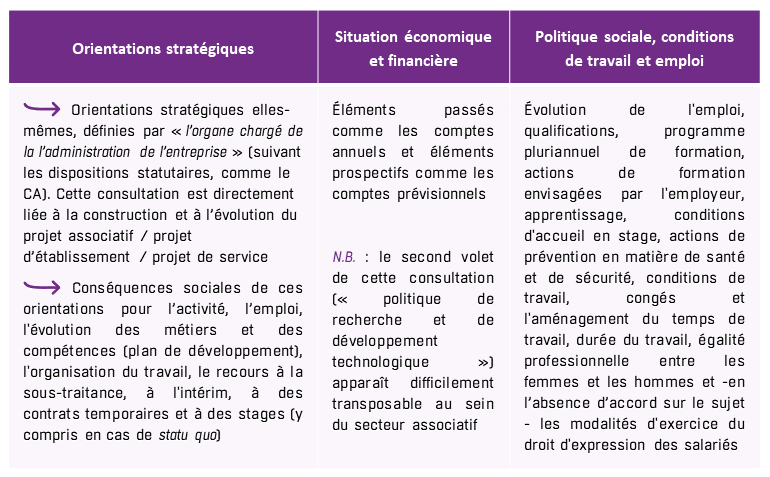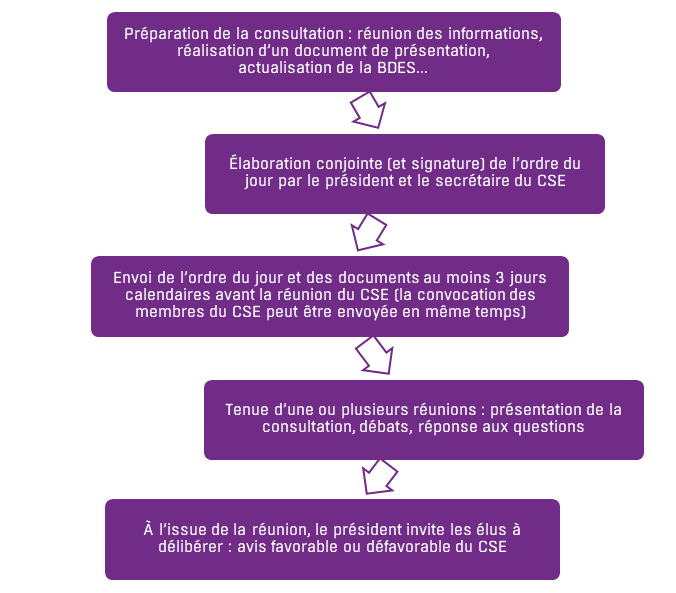A la suite des annonces gouvernementales et de la publication du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de la Covid-19 a été actualisé ce jeudi 29 octobre 2020.
Le Cabinet fait le point sur trois principaux sujets mis à jour dans le protocole : le télétravail, le « contact-tracing » et les tests de dépistage.
Déplacements, télétravail… Quelles obligations réelles pour les employeurs ?
Le protocole sanitaire prévoit que « Le télétravail est une solution à privilégier, lorsque cela est possible : il doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical. (…) Lorsque le télétravail ne peut être accordé, il convient d’assortir le travail présentiel de mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée (…). Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, il doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. (…) ».
Les termes employés laissent songeur : le télétravail est-il seulement « à privilégier » ou doit-il être totalement généralisé pour les fonctions « télétravaillables » ?
Ce 29 octobre, le Premier Ministre indiquait que « Le télétravail n’est pas une option ». Pourtant, la seule modification du protocole sanitaire, dénué de valeur normative, ne permet pas d’imposer aux employeurs la généralisation du télétravail.
D’ailleurs et à l’image du confinement « première mouture », le décret du 29 octobre prévoit que :
- Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits, sauf notamment les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit, sauf notamment – en « évitant » tout de même « tout regroupement de personnes » – les déplacements à destination ou en provenance du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés.
En bref : il n’est donc pas interdit de se rendre sur son lieu de travail, et il n’est pas légalement obligatoire de télétravailler.
En pratique, ce n’est pas tant sur la méconnaissance des termes du protocole sanitaire que l’employeur pourrait être inquiété, mais plutôt sur un éventuel manquement à l’obligation de sécurité qui, quant à elle, a bien une origine légale.
En effet, le fait qu’il soit demandé à un salarié de se rendre sur son lieu de travail durant la période de « confinement », hors nécessité inhérente à ses fonctions, pourrait se traduire par un manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels, indépendamment d’ailleurs de toute réalisation du risque.
Dans le même sens, en cas de réalisation de ce risque (la contraction du Covid-19 par le salarié ou ses collègues), le manquement à l’obligation de sécurité et/ou la recherche de la faute inexcusable de l’employeur pourrait être facilitée.
Dans une ordonnance du 19 octobre 2020, le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé que le protocole « constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ».
Rappelons en effet qu’au sein du justificatif de déplacement professionnel mis en ligne par le gouvernement (lequel qui n’est ni mentionné par le décret, ni annexé à celui-ci), l’employeur doit certifier « que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et le ou les lieux d’exercice de son activité professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ».
En cas de litige, l’employeur ne pourra donc pas dire qu’il ne savait pas…
N.B. : N’hésitez pas à consulter le replay du webinaire organisé par le cabinet et le magazine Direction[s] « Télétravail dans les ESSMS : une opportunité révélée par la crise sanitaire ? ». Un compte-rendu est également disponible en téléchargement gratuit ICI.
Le « contact tracing » : quelle gestion des données personnelles par l’employeur ?
Selon le protocole sanitaire, « les entreprises ont un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépistage (…) en collaborant avec les autorités sanitaires si elles venaient à être contactées dans le cadre du « contact tracing » (traçage des contacts) ».
La question se pose toutefois de la responsabilité de l’employeur dans le traitement des données personnelles du salarié et, en particulier, du traitement potentiel de ses données de santé.
A cet égard, la CNIL a publié un document intitulé « Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les employeurs », mis à jour le 23 septembre dernier, que nous vous invitons à consulter.
En synthèse, selon l’autorité de contrôle :
- Seuls peuvent être traités par l’employeur les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspectée de l’être ainsi que les mesures organisationnelles prises ;
- En cas de besoin, l’employeur sera en mesure de communiquer aux autorités sanitaires qui en ont la compétence, les éléments nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée. En tout état de cause, l’identité de la personne susceptible d’être infectée ne doit pas être communiquée aux autres employés ;
- Si le traitement des données relatives à l’état de santé sont en principe interdites, le cas du traitement des signalements – de positivité / négativité / cas contact – par les employés constitue, dans le contexte actuel, une exception ;
- Si le service de santé au travail est en principe seul autorisé à traiter les données de santé des salariés, la CNIL invite particuliers et professionnels à suivre les recommandations des autorités sanitaires et à effectuer uniquement les collectes de données sur la santé des individus qui auraient été sollicitées par les autorités compétentes ;
- Les tests médicaux, sérologiques ou de dépistage du COVID-19 dont les résultats sont soumis au secret médical : l’employeur ne pourra recevoir que l’éventuel avis d’aptitude ou d’inaptitude à reprendre le travail émis par le professionnel de santé. Il ne pourra alors traiter que cette seule information, sans autre précision relative à l’état de santé de l’employé, d’une façon analogue au traitement des arrêts de maladie qui n’indiquent pas la pathologie dont l’employé est atteint.
Bonne pratique : dans un souci de transparence, il ne peut qu’être préconisé à l’employeur d’informer les salariés sur ces modalités de collecte, de traitement et de communication aux autorités compétentes des données personnelles dans le cadre de la gestion du contexte épidémique. Notons que le protocole indique désormais que « l’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail. » Une information « commune » sur le traitement des données personnelles et sur l’existence de l’application gouvernementale pourrait ainsi être effectuée via plusieurs canaux : diffusion d’une note interne affichée et remise lors de l’embauche, mention dans le plan de continuité de l’activité…
Les tests de dépistage sur le lieu de travail
Nouveauté du protocole actualisé, « les employeurs peuvent, dans le respect des conditions réglementaires, proposer à ceux de leurs salariés qui sont volontaires, des actions de dépistage. A cette fin, la liste des tests rapides autorisés et leurs conditions d’utilisation ont été rendus disponibles par les autorités de santé. Ces actions de dépistage doivent être intégralement financées par l’employeur et réalisées dans des conditions garantissant la bonne exécution de ces tests et la stricte préservation du secret médical. En particulier, aucun résultat ne peut être communiqué à l’employeur ou à ses préposés ».
Sont ici visés les tests rapides « antigéniques » (le test est censé permettre un repérage des protéines du virus en moins d’une demi-heure), autorisés par arrêté paru au Journal officiel le 17 octobre 2020 pour réaliser des opérations de dépistage mais pas pour les personnes avec des symptômes ou les « cas contacts ».
Attention toutefois : il reste impossible pour l’employeur d’imposer à l’un de ses salariés un test de dépistage, quand bien même il serait le « relai » d’une campagne de dépistage menée par l’ARS.
En effet, les tests sont des actes de biologie médicale auxquels le salarié doit nécessairement consentir, sans que l’employeur ne puisse exercer son pouvoir disciplinaire à cet égard.
Aussi, pour que les salariés soient réellement contraints de passer ces tests pour l’exercice de leur activité professionnelle, de simples communications des autorités de santé ne suffisent pas et l’intervention du législateur apparaitrait nécessaire.
Un parallèle pourrait d’ailleurs effectué avec l’obligation vaccinale, pour laquelle l’article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique prévoit qu’une « personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe », étant rappelé que ces obligations sont suspendues pour la grippe saisonnière (Décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006) et la fièvre typhoïde (Décret n° 2020-28 du 14 janvier 2020).
Or, pour la grippe saisonnière, des campagnes sont menées chaque année par des ARS, en particulier pour les « professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère » sans que la vaccination ne soit obligatoire pour ces salariés.
À notre sens, c’est donc dans un cadre similaire qu’interviennent les recommandations données par les autorités (par exemple, la « recommandation d’un test RT-PCR SARS COV2 chez les professionnels de santé » du Ministère des Solidarités et de la Santé du 20 août 2020) ou les campagnes de dépistage du Covid-19 menées par les ARS.
N.B. : Article à jour au 30 octobre 2020, date de sa publication.