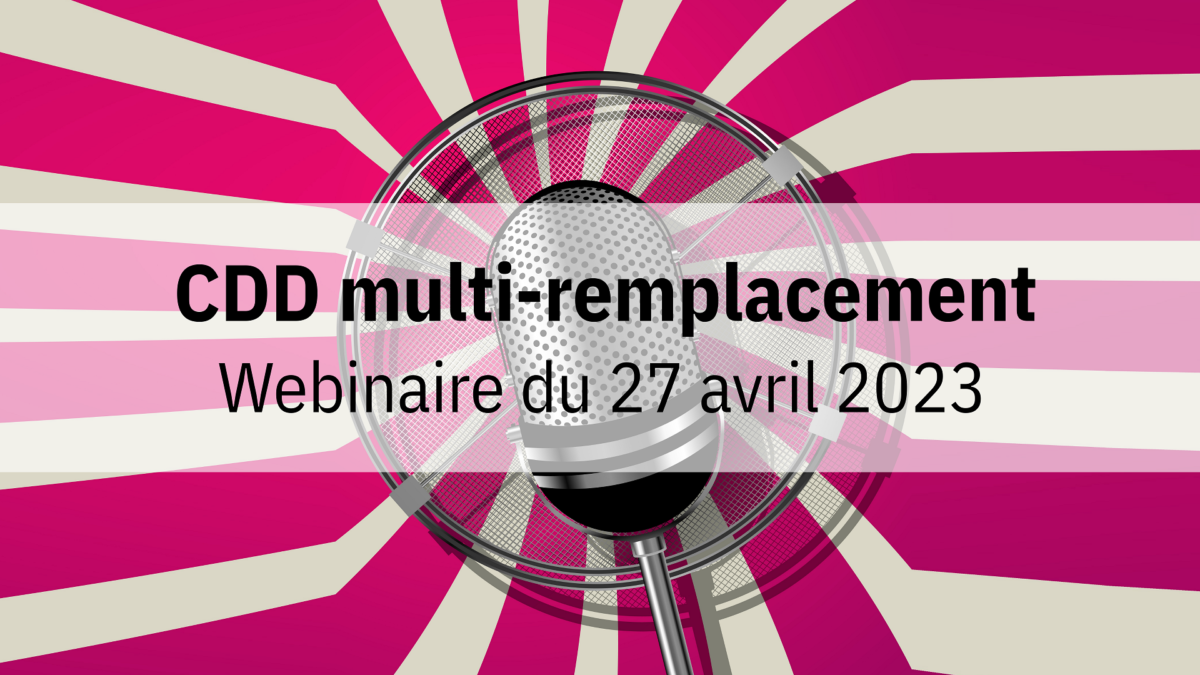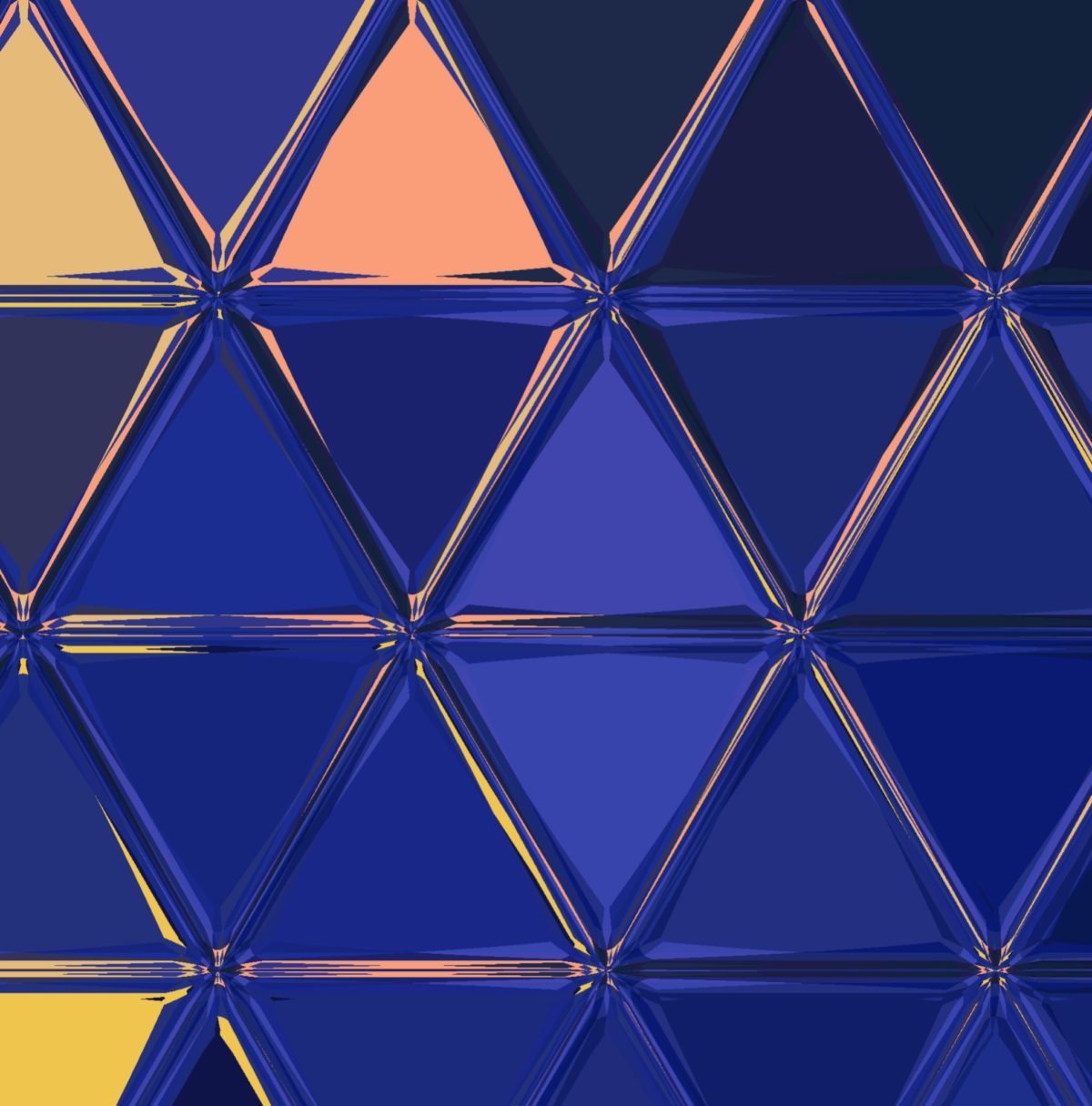Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (dit « projet de loi obligation vaccinale et passe sanitaire ») a été définitivement adopté ce dimanche 25 juillet par le Parlement.
Le texte, disponible ICI, compte de nombreux changements par rapport aux premières annonces gouvernementales et au projet initialement adopté par l’Assemblée nationale (voir notre flash info du 23 juillet). La rédaction définitive laisse également place à des incertitudes et difficultés d’interprétation inopportunes pour les employeurs devant gérer la mise en œuvre de ces mesures durant la période de congés estivaux.
Décryptage des principales mesures sociales du texte liées notamment au « passe sanitaire » et à l’obligation vaccinale.
Passe sanitaire dans les ESSMS ?
Le chapitre 1 de la loi concerne les « dispositions générales » applicables à de nombreux secteurs dont les ESSMS, s’agissant en particulier du passe sanitaire. À la différence du chapitre 2 de la loi qui liste d’ores et déjà les établissements concernés par l’obligation vaccinale, la mise en œuvre du passe sanitaire est conditionnée à un décret du Premier ministre à paraître.
Par conséquent et à la lecture du texte, certains ESSMS pourraient à la fois être soumis aux dispositions relatives au passe sanitaire (Chapitre 1) et à l’obligation vaccinale (Chapitre 2).
Dans ce contexte, l’articulation entre ces dispositions ne serait pas sans difficulté puisque les conséquences juridiques pour les salariés « en défaut » diffèrent sensiblement selon qu’il s’agisse de l’absence de passe sanitaire ou de vaccination.
Il conviendra naturellement d’attendre le contenu des dispositions réglementaires pour être fixé.
- Structures concernées par le passe sanitaire : la liste réglementaire en attente
Jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut notamment subordonner l’accès à certains lieux à la présentation du « passe sanitaire » : résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement.
Au sein des services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, le pass sanitaire pourra ainsi être applicable :
- Dès la promulgation de la loi, au public, sauf en cas d’urgence, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
- À compter du 30 août 2021, aux « personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue » : le texte ne définit pas quelles sont ces « intervenants » mais il devrait s’agir des professionnels et bénévoles, comme le soulignait le Conseil d’État dans son avis du 20 juillet ;
- À compter du 30 septembre 2021, aux mineurs de plus de douze ans.
Par conséquent, tous les ESSMS ne seront pas concernés : il conviendra d’attendre le décret pour connaître la liste des structures concernées, le pouvoir réglementaire devant déterminer cette liste en fonction de la vulnérabilité du public accueilli.
- Conséquences pour les salariés non titulaires du passe sanitaire dans les ESSMS concernés
Lorsqu’un salarié travaillant dans une structure soumise au passe sanitaire ne présente pas les justificatifs requis, il peut, avec l’accord de son employeur, poser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. Ni le salarié ni l’employeur ne sont ainsi dans l’obligation d’accepter une telle pose de congés.
À défaut ou si ces jours de congés sont insuffisants, l’employeur notifie au salarié, le jour même et par tout moyen (SMS, mail, courrier remis en main propre…) la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. En pratique, cette situation risque de poser de sérieuses difficultés liées à la gestion du remplacement du salarié et à sa reprise « sans délai » du travail une fois les justificatifs produits.
Par suite, lorsque cette situation se prolonge au‑delà de trois jours travaillés, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
En revanche, le Parlement s’est accordé pour abandonner la possibilité de licencier pour cause réelle et sérieuse le salarié qui ne pourrait plus exercer son activité.
De façon pour le moins surprenante, les parlementaires ont conservé la faculté de rupture anticipée du CDD et du contrat de mission à l’initiative de l’employeur.
Interrogations. En premier lieu, le texte ne précise pas les modalités de l’entretien lié à la suspension du contrat de travail : dans quel délai doit-il être tenu ? Le salarié peut-il être assisté et le cas échéant par qui ? Dès lors que le salarié ne peut avoir accès à l’établissement faute de passe sanitaire, peut-il avoir lieu au téléphone ou en visio ? Un compte-rendu doit-il être établi ?
Par ailleurs, si l’employeur est tenu d’échanger avec le salarié sur les « possibilités d’affectation » sur un autre poste non soumis à l’obligation de passe sanitaire, quelle est la portée réelle de cette obligation ? L’employeur encourt-il un risque lié à un défaut de « reclassement temporaire », au-delà de la seule question de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et alors même que la situation résulte du fait du salarié ?
Aussi et de façon paradoxale, ces dispositions apparaissent à la fois plus légères et plus étendues que les procédures « classiques » de reclassement – non temporaire – liées à l’inaptitude ou au licenciement économique :
- Plus légères, car textuellement, le législateur ne soumet pas à l’employeur une obligation de reclassement, l’étude des possibilités d’affectation n’étant qu’un « sujet » d’échange avec le salarié sur les moyens de régulariser sa situation. Or, l’on voit mal comment il appartiendrait à l’employeur d’être tenu de régulariser lui-même, par le biais d’une réaffectation, la situation du salarié résultant de son propre fait ;
- Plus étendues, car le texte se veut particulièrement lacunaire : tel que rédigé, la réaffectation pourrait être envisagée sur des postes non « équivalents », comme cela est le principe en matière de reclassement. L’emploi de l’adverbe « notamment » sous-entend également que d’autres moyens de régularisation pourraient être envisagés, comme le recours au télétravail total ou partiel.
Contrairement à ce qui est prévu pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale (v. ci-après), le texte ne précise pas que la période de suspension contractuelle pour défaut de passe sanitaire ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté, ni que le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Obligation vaccinale dans les ESSMS
- Personnels soumis à l’obligation vaccinale
Doivent notamment être vaccinés contre la covid‑19, sauf contre‑indication médicale reconnue :
- les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé (art. L. 6111‑1 du CSP), les centres de santé (art. L. 6323‑1 du CSP) et les maisons de santé (art. L. 6323‑3 du CSP), les ESMS mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du CASF, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du CCH destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées qui ne relèvent pas des ESMS mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du CASF, les résidences‑services (art. L. 631‑13 du CCH), les habitats inclusifs (art. L. 281‑1 du CASF) ;
- Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du CSP ainsi que les personnes faisant usage du titre de psychologue, de psychothérapeute, d’ostéopathe ou de chiropracteur ;
- Les étudiants des établissements préparant à l’exercice de ces professions ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels.
Un décret doit déterminer les conditions de vaccination contre la covid‑19 de ces personnes, les différents schémas vaccinaux et le nombre de doses requises.
Si cette obligation s’applique à compter du lendemain de la publication de la loi, les parlementaires ont prévu une période transitoire :
- Jusqu’au 14 septembre 2021, le personnel concerné pourra travailler en présentant le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif au covid-19 (pour sa durée de validité) ;
- À partir du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021, sont autorisées à exercer leur activité les personnes soumises à l’obligation vaccinale qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.
À noter que contrairement au passe sanitaire, aucune limitation de durée n’est prévue pour l’obligation vaccinale. Toutefois, un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé pourra, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre l’obligation vaccinale pour tout ou partie des personnes concernées (à l’image de la suspension opérée en 2006 pour le vaccin contre la grippe et en 2020 pour la typhoïde).
Ainsi, l’obligation vaccinale ne concerne pas que les soignants. Comme l’exposait déjà l’étude d’impact du projet de loi, « l’obligation s’applique aux professions réglementées comme aux professions non réglementées qui sont susceptibles d’être le plus en contact avec les publics fragiles, plus sensibles au virus du SARS-CoV-2. Cette obligation permettra de limiter le risque de contamination par des professionnels ou bénévoles des secteurs sanitaires, social et médicosocial ou au sein des structures dans lesquelles ces personnes exercent leur activité. »
En revanche, l’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes soumises à l’obligation vaccinale exercent ou travaillent.
De notre lecture, les personnels des sièges administratifs ne devraient pas non plus être concernés dès lors qu’ils n’exercent pas leur activité dans l’un des ESSMS listés par la loi.
À noter également que lorsque l’employeur constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de trente jours, il doit en informer le conseil national de l’ordre dont ce professionnel relève.
- Conséquences pour les salariés non vaccinés
La rédaction du texte définitif soulève des incertitudes, dans la mesure où les conséquences sur le contrat de travail prévues en matière de passe sanitaire (Chapitre 1) ne sont pas reprises dans les mêmes termes en matière d’obligation vaccinale (Chapitre 2).
Le texte prévoit que lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité compte tenu du non-respect de l’obligation vaccinale, il doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, à savoir la suspension de celui-ci sans rémunération, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
Comme pour le défaut de passe sanitaire, le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer faute de vaccination peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. En revanche, le texte ne prévoit pas d’obligation de convoquer le salarié à un entretien et d’échanger avec lui sur les facultés de réaffectation au sein de l’entreprise.
Là encore, la suspension du contrat de travail cesse de plein droit dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Cette fois, le texte précise expressément que cette période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (disposition d’ordre public).
Comme pour le passe sanitaire, la possibilité de licencier pour une cause réelle et sérieuse le salarié ne respectant pas l’obligation vaccinale a été supprimée.
Toutefois, la faculté de rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur pour défaut de vaccination n’est pas prévue. En revanche, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Autres dispositions
- Autorisation spéciale d’absence rémunérée
Une autorisation d’absence rémunérée et assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou liés à l’ancienneté est octroyée :
‒ Aux salariés, stagiaires et agents publics se rendant aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19 ;
‒ Au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.
- Information et consultation du CSE
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le CSE (ou le cas échéant le CSEC) des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au passe sanitaire et à l’obligation vaccinale.
L’avis du CSE – qui implique donc une consultation – peut intervenir sous un mois (contre 2 mois initialement prévus) à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.
Saisine du Conseil constitutionnel
Comme attendue, une première saisine du texte vient d’être enregistrée par le Conseil constitutionnel, lequel a d’ores et déjà précisé qu’il rendra sa décision le 5 août.
La promulgation de la loi est donc logiquement attendue pour le 6 août.